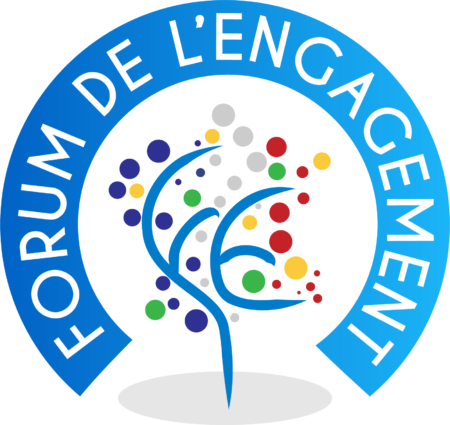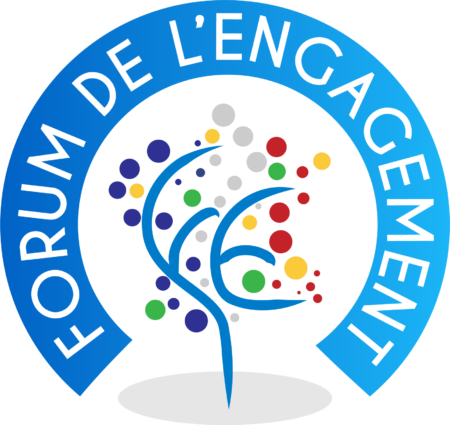Dans le livre de Lewis Carrol De l’autre côté du miroir (la suite des Aventures d’Alice au pays des merveilles), on voit la Reine rouge prendre Alice par la main pour courir. Mais plus elles courent, moins le paysage bouge aux alentours ! Face à l’étonnement d’Alice, la Reine lui explique qu’il faut courir sans cesse pour rester sur place. C’est une excellente image de ce qui se passe dans notre société, où les gains d’efficacité sont sans cesse rattrapés, annulés, dépassés par l’envolée des consommations.
Dans le transport aérien civil, chaque kilomètre de vol par passager consomme environ trois fois moins de carburant qu’il y a quarante ans. Voilà qui est bon pour la planète, direz-vous. Hélas non, car la baisse des coûts a fait que le voyage aérien s’est considérablement développé et démocratisé. Le nombre de kilomètres de vol a explosé. En 2017, on a dépassé 4 milliards de passagers dans les vols de l’aviation civile dans le monde. Alors que le volume de GES émis par passager-kilomètre diminuait de moitié, le volume total d’émissions a été multiplié par deux ; L’impact global sur les consommations de matières et d’énergie a crû considérablement.
Prenons un autre exemple, plus banal encore, celui de l’éclairage. Aucune de nos activités courantes n’a connu sur le long terme une telle augmentation d’efficacité et une chute aussi vertigineuse du coût par unité produite (Au passage, cela signifie que le fameux retour à la bougie évoqué par les écolo-sceptiques serait une catastrophe écologique !). Mais la consommation, d’abord portée par le gaz de ville, puis par l’électricité, a plus que rattrapé cette augmentation d’efficacité. Elle a été, grosso modo, multipliée par dix tous les cinquante ans.
Depuis les débuts de l’éclairage urbain dans les années 1830 jusqu’en 2000, le nombre de lumens-heure a été multiplié par 100 000. Le résultat est que désormais on voit nos villes nocturnes de l’espace, comme sur les belles images envoyées par Thomas Pesquet ! Mais l’aviation et l’éclairage ne sont que des illustrations d’un phénomène universel, que l’on va retrouver pour les mobilités, pour le chauffage, pour l’informatique, pour l’habillement. En réalité, pour la quasi-totalité de nos activités.
Des biens et des services moins coûteux
Ainsi, « le moins alimente le plus », écrit le [chercheur et analyste politique canadien] Václav Smil. Le signe de ce rattrapage, ou débordement, par la demande est que les gains d’efficacité constatés au niveau « macro » sont nettement plus faibles que ceux qu’on observe au niveau « micro ». Ils existent néanmoins.
Pour l’ensemble du monde, la quantité de gaz à effet de serre (GES) par unité de PIB a ainsi diminué d’un tiers depuis 1990. En France, elle a baissé de 50 % (si on s’en tient aux émissions sur le territoire national : rappelons que le carbone incorporé dans nos importations représente désormais plus de la moitié de notre empreinte réelle). En Chine, qui partait de loin, la baisse de ce ratio « tonnes de GES par unité de PIB » a été beaucoup plus rapide encore, même si, à ce jour, il reste sensiblement plus élevé que dans les pays occidentaux. […]
[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Pourquoi les gains d’efficacité réalisés au niveau « micro » sont-ils ainsi atténués, voire dilapidés ? La réponse est très simple. L’efficacité rend les biens et les services moins coûteux, plus accessibles, plus désirables, et la demande, dopée par la publicité et par les multiples formes de l’effort pour vendre, croît en proportion, ou même davantage. On appelle cela l’effet rebond, ou, si on veut avoir l’air savant, l’effet ou le paradoxe de Jevons.
En 1865, les producteurs de charbon britanniques s’inquiétaient de l’efficacité croissante des machines à vapeur, qui utilisaient de moins en moins leur précieux combustible. William Stanley Jevons, homme d’affaires et économiste, un des fondateurs, avec Léon Walras, de l’école marginaliste, leur répondit :
« C’est une erreur complète de supposer que l’usage plus économique de l’énergie va faire baisser la consommation. C’est exactement le contraire qui va se passer. »
Un siècle et demi plus tard, il est difficile de lui donner tort
Le numérique, emblématique de l’effet rebond
Il y a beaucoup moins d’aluminium ou d’acier dans chaque canette de 33 centilitres, mais le nombre de canettes a tellement crû que la consommation d’acier ou d’aluminium pour les canettes s’est envolée (Un conseil, au passage : l’acier est un meilleur choix écologique, car plus facile à recycler !). Dans le monde numérique, les gains d’efficacité pour les processus de base sont très spectaculaires. Même les mégafermes de serveurs, sur lesquelles repose la croissance du cloud, sont de plus en plus efficaces en énergie et en émissions de carbone.
Les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ne mentent pas quand ils soulignent que ces hyperscalers (la dernière génération des infrastructures du cloud) sont 30 % à 50 % plus efficaces que les anciennes fermes. Mais, au bout du compte, il s’agit bien de permettre la multiplication des utilisations, notamment du côté du grand public, par le streaming vidéo en particulier.
L’empreinte globale du monde numérique, qui paraît léger et immatériel, a déjà dépassé celle de l’aviation civile et ne cesse de croître. Elle repose sur un effet rebond massif, le cœur du modèle économique des plates-formes étant précisément la croissance ultrarapide des volumes que permettent les effets de réseau. L’effet pervers est que ces augmentations sont insensibles pour l’usager qui échange des photos ou regarde des vidéos, et dont la consommation locale est négligeable au regard des coûts globaux.
Un autre domaine très problématique est celui du ciment et de la construction, où les gains d’efficacité (en énergie et en émissions de GES) restent relativement limités, parce que techniquement difficiles à obtenir, alors que la demande explose en Asie et en Afrique.
L’effet Jevons est donc omniprésent. Il peut être indirect – les baisses de prix dans un domaine dégageant du revenu disponible pour d’autres consommations – ou direct, par augmentation de la consommation du bien concerné. Bien entendu, la croissance de la demande n’est pas indépendante des stratégies marketing et commerciales déployées par les entreprises, qui mobilisent des ressources considérables. Le renouvellement plus ou moins frénétique des produits et des catalogues commerciaux reste un moyen classique pour doper la demande.
Pensez aux centaines de variantes des produits les plus simples qui apparaissent lorsque vous consultez Internet pour un achat banal. Les stratégies d’obsolescence programmée et d’accroissement incessant de la diversité se retrouvent même dans les modèles de services. Nous connaissons tous l’imagination avec laquelle les offreurs de logiciels arrivent à nous obliger de changer de version en permanence.
« Profondeur technologique »
Il y a une autre forme de « recyclage » des gains d’efficacité, analogue à l’effet rebond mais beaucoup moins étudiée : c’est la progression incontrôlée de la complexité technique et fonctionnelle de nos objets. […] En lien avec la globalisation, nos objets sont devenus en quelques décennies considérablement plus compliqués que ceux des générations précédentes, tant par le nombre de composants que par leur complexité technologique. Les microprocesseurs, par exemple, se sont disséminés bien au-delà de nos ordinateurs et de nos portables. L’Internet des objets nous promet une vague encore plus puissante et étendue.

Or il est certain que cet effet de « profondeur technologique » pèse lourd dans la balance climatique, même si personne, à ma connaissance, ne l’a chiffré. Derrière nos objets et nos services quotidiens, on trouve maintenant des réseaux de plus en plus labyrinthiques d’activités productives, avec des myriades de fournisseurs en cascade – ce qui, soit dit au passage, rend irréaliste l’idée de certains économistes de pister précisément les impacts écologiques de ces chaînes en recensant toutes les activités qui les composent.
L’évolution de nos voitures est un bon exemple. Au lieu de rendre les modèles plus simples (et beaucoup moins coûteux), les gains d’efficacité ont été recyclés principalement dans une formidable augmentation de complexité, avec une part énorme désormais consacrée à l’électronique et, de plus en plus, au logiciel.
Bien sûr, une partie de ces nouveaux équipements et des nouvelles fonctionnalités imaginées par les bureaux d’études est très utile. Qui voudrait se passer de fonctions de sécurité comme l’ABS, ou même de confort comme la caméra arrière ? Mais le processus d’ensemble est à l’évidence piloté davantage par la passion des ingénieurs et la créativité du marketing que par une analyse des véritables besoins des usagers, et encore moins par celle des conséquences écologiques. Il ne s’agit pas de refuser les avancées de la technique, ni de les brider par avance. Il faut cependant bien constater qu’il n’existe aucun forum, ni dans la société, ni dans les entreprises, pour exercer ce que [l’ingénieur] Philippe Bihouix appelle le « techno-discernement ».
« N’importe quelle mesure du progrès dans le niveau de vie de l’individu donne un coefficient de progrès incomparablement plus faible que dans la quantité d’énergie dépensée par habitant », écrivait déjà [l’écrivain] Bertrand de Jouvenel dès la fin des années 1950. Depuis, cette quantité a été multipliée par 7, et nettement plus pour les plus riches d’entre nous. Vivons-nous sept fois mieux ?
L’ingénieur Jean-Marc Jancovici rappelle souvent que nous ne consommons pas d’énergie. Ce qui consomme de l’énergie, ce sont les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de machines qui travaillent pour nous, machines dont nous avons oublié l’existence, car la plupart d’entre elles sont très lointaines, devenues « abstraites » à nos yeux.
Reprenant une image proposée par [l’architecte américain] Buckminster Fuller dès 1940, il parle des « équivalents-esclaves » qui sont à notre disposition, en prenant comme unité l’énergie déployée par un humain en une journée de travail. Leur nombre est faramineux et se chiffre en centaines. Cette image montre à quel point nos processus se sont auto-emballés depuis un siècle, et même un demi-siècle. Elle est aussi source d’espoir, car elle suggère qu’une réduction substantielle de notre extravagant train de vie est possible en gardant l’essentiel de nos acquis, surtout si on partage mieux nos « esclaves ».
Ce texte est extrait du livre « Bifurcations : réinventer la société industrielle par l’écologie ? » de Pierre Veltz, publié aux Éditions de l’aube en octobre 2022. Les intertitres ont été ajoutés par la rédaction.
Retrouvez cet article directement sur The Conversation